Ebullitions ou la démesure du réel - Part 2 - Par Charles Letellier
Je choisis un mal pour un bien. Ou l’inverse. C’est la même chose. Je préfère encore ce qui est cruel à ce qui est mièvre. Non pas que le bien soit nécessairement fade et le mal forcément cruel, mais bien souvent, par un rapprochement difficile à admettre, ce qui est cruel est plus proche de la vérité que ce qui est simplement « bien ». Lieu commun à rappeler à la gueule de cette saleté d’époque puante, dans laquelle il nous est forcé de vivre, nous qui les derniers (?) nous acharnons à vivre au dessus de ces petites contingences qui forment, tout autant qu’elles déforment le quotidien… Par delà… Oui, par delà ces bons sentiments mesurables à leur fausseté, définissables par leur repoussante et dégoûtante facilité, de laquelle ils puissent leur source. Ma source est autre. Elle bouillonne trop pour être admise. Elle est trop chaude pour être commune. Je sais vivre déjà trop éloigné de ce qui est admis pour utiliser le langage de la norme-alitée. Il paraît que j’ai des mots durs, qu’ils blessent autour de moi comme des coups de couteau. Certains ne tardent pas à pleurer lorsque j’ai fini de m’exprimer. D’autres veulent ma peau. J’ai même le privilège d’être haïs, haute distinction pour celui qui combat la merdiocrité, encore que rares sont ceux dont la répugnance m’honore. On juge un homme à ses fréquentations et à la qualité de ses ennemis. Je dois dire que si on s’astreignait à ne me juger que d’après mes opposants, je serai un bien piètre baladin.
Ai-je été trop loin, définitivement trop loin ? Lâché comme un fou dans le flux invisible qui enrubanne les choses, suis-je, par mégarde, resté perché sur la branche que j’avais déjà commencé à scier ? Je me suis coupé de bien des choses afin d’en trouver d’autres, plus vraies, plus féroces, plus violentes dans leur véritensité. J’en ai oublié mon travail, ma famille, ma patrie. C’est très regrettable… Délaissant tout pour le vrai travail, celui des montagnes Russes entre bas-fonds puants et sommets étourdissants, j’ai refusé de reconnaître le sens du mensonge pour arracher aux autres leur propre naïveté, pour qu’ils me confient le gamin de leur être plutôt que l’adulte de leur misère. Ici je veux parler de moi, ou plutôt, en finir avec moi une bonne fois pour toutes. Celui-ci, ce moi, devient par trop ingérable et intolérable, il en veut trop et plus chaque jour et je ne sais où cela me mènera si demain il réclame mon cœur et ma tête sur un plateau. Cette vieille histoire de l’écrivain qui n’écrit que sur lui-même n’a plus court, on sait désormais que c’est lui-même qu’il écrit. Lui-même… Du moins, l’écho du monde en lui dont il est le réceptacle unique, si il sait l’être. Cet intenable chantage du corps et de la tête qui jamais ne cesse et dans lequel il n’est rien d’autre à faire que de tenter de nager sans se noyer. Parce qu’à vrai dire, vouloir faire autre chose, c’est déjà se lancer dans la fiction. C’est éviter la confrontation ultime. Et donc passer à côté de la vérité. La fiction ne m’intéresse pas. Du moins, pas pour l’instant, que je suis encore tout disponible à refuser le mensonge. (Qui sait, pour un peu d’argent… ?) Mais voilà que je recommence à suffoquer alors je me défroque comme il se doit, selon les règles, les principes fondateurs: la main droite sur l’Antéchrist et la gauche sur l’estomac. Il est temps de l’essentiel. Plus le temps de rire, l’heure est grave. S’il reste un truc à gratter au-dedans de ce monticule profond qu’est le corps, il ne faut pas hésiter, il faut y plonger, quitte à revenir en deux fois, voir à ne pas revenir du tout. C’est lui qui a le secret, le corps. C’est pas dans les bouquins, le secret. C’est dans la chiasse. Dans la vomissure aux commissures des lèvres. Dans le ragoût fluvial des égouts de miel, ce nid sous le roc, au fond, au bout, tout au bout… Guidé par une vision cramoisie à l’odeur de roussi, je me pose, un peu perplexe, en funambule… Mais je m’égare… On peut en faire de la poésie, tant qu’on veut. Ça va rien changer finalement. On croit que ça peut ventiler les tertres, démolir les flanelles tombales et puis, et puis… Et puis, y a toujours ce moment précis où on s’y trouve, justement, sur le tertre, armé à plein poumon, le cœur dans ses mots et boum ! ça valdingue dans l’autre sens, ça retombe sur les dents sur un bord de trottoir. Et après, il faut bien se relever quand même ! Faut bien y retourner ! Faut de nouveau être furieux ! Faut tout refaire ou presque parce qu’on n’était pas prêt là-haut, pas encore de la bonne humeur… alors y a rien qui est resté… Retour à la case départ. Pas le choix. C’est un jeu. Un jeu de tortionnaire, peut-être le plus terrible et le plus silencieux de la Terre puisqu’aussi bien, il n’y a que les cellules qui trinquent… Bon, c’est vrai, y en a qui surmonte… Et les mots, après, pour raconter, pour dire, pour incarner, ces mots ne sont plus les mêmes, ils ont un regard malin qui vous observe presque sournoisement, c’est plus la même histoire, plus le même chevrotement dans le style. En fait, y a même plus de chevrotement. Ça sait directement, sans preuve et sans hésiter, cela devient corporellement spirituel ou spirituellement physique. Les deux bouts se rejoignent. Nul ne sait la qualité du cataclysme à venir. Mais voilà, moi, qui me sacrifie purement et totalement, j’ai pas encore « gagné » mon aller-retour, avec ou sans retour, corps-esprit. Pour l’instant, j’en sais foutrement rien. Pour l’instant, je ne suis qu’un instinct, une intuition physique, une entité râpeuse, un esprit chamboulversant. Peut-être un peu Quichotte et pas encore assez Don. Qu’importe j’y vais à l’aveuglette puisqu’il s’agit bien d’illuminer. Alors, voilà, on est parti, partie, tout, ensemble, démesuré, incalculable, même pas machinale, ni décimale. Suivons le court trajet qui mène imperceptiblement d’ici à là, tout près du fauteuil de la chambre, de la vieille dame dans le métro, assis sur un banc, avec ces maudits pigeons, entre une morve verdâtre et un chêne centenaire. Tout près et partout à la fois. C’est une boucle qui tend à s’ouvrir. On se dit que la rodomontade est un bien piètre artifice, que je ne manque pas d’air, que je ne suis qu’un petit con, un enfant gâté, un petit minable, tient, mettons ! Enfin, rien de bien précis, rien qui puisse déjouer ma passion de savoir de l’intérieur. Qu’on se le dise : j’m’en fous pas mal et surtout des pisses-secs au vit rabougrit et au con sec comme cette putain de vallée de la mort ! Car pour ce qui est de donner, rassurez-vous, j’ai besoin des conseils de personne et surtout pas des plus rats parmi vous, les plus promptes, le plus avides de montrer leur grand cœur au passant, les « amis » qui ne supportent pas votre soif et qui tentent de vous assécher… Je n’ai plus d’amis ! Je n’en veux plus ! Vous m’entendez ? JE N’EN VEUX PLUS ! J’suis passé pas loin, des fois, d’en crever, à force d’aimer. Alors, j’me la raconte plus, l’histoire, assez ! J’me la fait ! Tout entière ! Un peu trop, pas assez… C’est à voir… Et puis, tant pis ! Si ça ne marche pas cette fois-ci, on verra bien pour celle d’après… En tout cas, c’est ici que ça redémarre. Pour de bon.
A suivre...
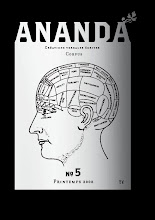

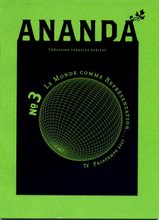



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire